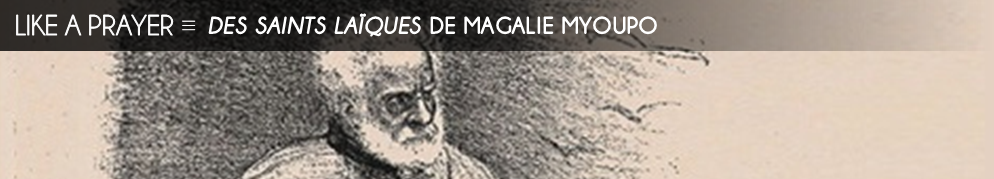Par Esther Fléty – Notre humanisme CET OUVRAGE EST PERCUTANT, DANS LA MESURE où il se refuse à détourner le regard. Nastassja Martin introduit l’ouvrage en remettant l’humain, en tant qu’espèce, au centre du propos. Elle explique qu’au-delà de notre appétence pour le progrès et la modernité, il demeure en nous des traces de cette humanité latente. Le souvenir que, avant de s’être installés au sommet de la pyramide des superprédateurs, les humains ont dû batailler et coopérer pour s’insérer durablement dans la constellation du vivant. C’est par ce biais qu’elle introduit son objet d’étude : les glaciers et leurs hôtes, les montagnes, « nos dernières frontières » (p. 5), ces « bords du monde à la morphologie exigeante » (p. 5) face auxquels nous avons dû rebrousser chemin. Ces « déserts » (p. 5) comme l’auteur les appelle, ont « résisté à la mise en disponibilité de chaque partie du monde » (p. 5) et ont gardé une partie de leur sauvagerie et de leur aura intimidante. En leur cœur sommeillent les glaciers, ces métronomes de la vie, que nous avons malgré tout réussi à atteindre : « Les montagnes et leurs glaciers comme autant de dragons terrassés par une humanité qui, chaque jour, nous montrent ce que nous avons fait au monde » (p. 5).

« QUELQUE CHOSE MEURT » (p. 6) : VOICI LE POSTULAT INTRODUISANT l’ouvrage. Si les glaciers se meurent, l’auteur fait surtout référence à la manière dont on se représente le monde, c’est-à-dire une opposition entre nature et culture. Elle se réfère en effet aux théories de l’anthropologie de la nature nées sous la plume de l’anthropologue français Philippe Descola. Ces deux derniers estiment que la « nature » n’existe pas, qu’elle est en réalité une construction sociale, une représentation particulière du monde que nous considérons comme étant la vérité. C’est ce que l’on appelle « l’ontologie naturaliste » (Philippe Descola,
Par-delà nature et culture, 2005.). Le propos de notre autrice est donc fondé sur ce paradigme qui vise à rappeler aux lecteurs que l’humain fait partie, à part entière, de cette « nature » de laquelle il tend à s’exclure. Ce qui, selon les auteurs, meurt, c’est notre représentation du monde, dans le sens où, avec l’intensification de la crise climatique, nous nous rendons compte que notre manière de faire est destructrice et que nous prenons conscience de la marque que l’on a faite au
cosmos (terme de Nastassja Martin pour parler du monde) : « Nous avons stabilisé une idée de la sauvagerie à dompter en nous et hors de nous » (p. 7).
NASTASSJA MARTIN ABORDE PAR LA SUITE LA QUESTION de « l’ontologie Naturaliste » évoquée précédemment, et mentionne que dans notre société, nous avons une propension à ne connaître le monde que par le biais de la science. Dans une analyse très intéressante, elle estime que cette approche par les sciences de la connaissance de la nature, en l’occurrence, prend sa source au XV
e siècle avec Léon Battista Alberti et la naissance de la perspective linéaire : « Ce point de vue sert de point de départ à la rationalisation du monde » (p. 8,
ibid Descola, 2004, p. 94). C’est alors que l’autrice met en exergue un point essentiel de son développement : « l’objectivation » de la nature. Ce processus s’enracinerait donc dans notre société depuis la Renaissance, et évoquait la transformation d’un sujet (nature) en objet (nature dévoilée par la science, connaissance de ses qualités et exploitation de son potentiel). Les sciences deviennent alors les seuls vecteurs de connaissance du monde : « Le projet scientifique, qui révise la cosmogénèse tend vers un but : percer les secrets de la nature ». (p. 9) La montagne a donc subi cette objectivation, elle est libérée de ses secrets et objectivée.
– Revenir au sauvage IMAGINER LE MONDE QUE L’ON HABITE, MAIS AUSSI apprendre à lire l’ailleurs comme une manière de réapprendre à regarder ce monde-ci. Même si nous l’avons objectivée, la montagne garde une aura terrifiante, elle nous rappelle que nous sommes vulnérables face à son immensité et nous renvoie à notre humanité latente – elle demeure bien « nos dernières frontières ». Nastassja Martin trouve néanmoins un point positif à notre compréhension du monde : la science nous a permis de nous rendre compte que les glaciers sont décisifs pour la constellation du vivant – « L’eau [qui] passe d’un état à un autre et offre une respiration au monde » (p. 16). Les auteurs nous proposent de trouver des solutions, des manières de faire marche arrière auprès de collectifs non-« naturalistes » et d’essayer de retrouver un contact sauvage avec le monde.

APRES L'EXPOSITION DE DIVERSES PROPOSITIONS DE REHABILITATION de la « sauvagerie » et considérant qu’une mutation du discours sur la crise climatique est nécessaire, Nastassja Martin prend l’exemple de la manière de vivre des
Aymara, populations des Andes, et de leur rapport au monde, considérant les glaciers comme de « lointains parents » (p. 20) et communiquant avec eux par les airs (par la voix, les instruments à vent etc…) : « l’air ensemencé devient l’espace d’une pensée, pensée qui n’est pas le monopole des humains » (p. 22). Ces andins échangent avec le reste du cosmos et le conçoivent comme un monde de flux et de transmission de mémoire, comme celle enfermée dans la glace qui se libère avec sa fonte : « nous respirons les plantes et aussi les glaciers. Et, ils nous respirent en retour. En nous, en eux, la mémoire circule. » (p. 23). Leur approche de la mémoire et de sa captation est opposée à celle de la société « naturaliste », aujourd’hui mondialisée : « Les images que nous conservons dans notre musée imaginaire sont moribondes, comme des reliques coupées des relations à leurs témoins, elles ne parlent plus » (p. 23).
– Les monstres blessés CAR L’OBJECTIF, ICI, EST BIEN DE SCRUTER CE QUE NOUS avons perdu l’habitude d’admirer. Le photographe Olivier de Sépibus nous propose, après la partie écrite, une sélection de certaines de ses photographies prises dans les Alpes françaises et capturant la montagne et les glaciers pour ce qu’ils sont. Sans présence humaine, le photographe montre la montagne non pas comme un fond ou un environnement dans lequel l’homme s’évade, mais comme des entités autonomes émergeant lentement depuis des millénaires. Le photographe estime, à juste titre, que nous avons perdu l’habitude d’admirer les choses. Originaire des Alpes, il avait l’habitude de se rendre au Massif des Écrins. Après quinze ans d’absence, il s’y rend de nouveau et constate le recul du glacier qu’il avait l’habitude de voir. La perte est considérable, la sensation est telle qu’il a l’impression d’avoir perdu un membre de la famille et a décidé de témoigner de cette disparition en photographiant les glaciers « comme des corps musclés vieillissants, ivoire sale et terni, plus de bleu, plus de reflet » (p. 6). Il les a scrutés pour capturer leurs couleurs, leur dynamisme et ce qu’ils créent : c’est-à-dire la vie. « Activité ancienne du regard, celle du chasseur sur la trace de la bête à tuer, du marin à l’approche d’une terre, du berger pour mener le troupeau, de l’alpiniste qui lit une face la veille d’une ascension. »
LE PHOTOGRAPHE DIVISE SON TRAVAIL EN CINQ SECTIONS. Chacune a un titre renvoyant au motif principal des photos sélectionnées, et elles sont accompagnées de poèmes de René Char. La première s’intitule
Cryos/Froid : on y perçoit le résultat du temps long, du mouvement millénaire de la glace. Son changement d’état, son immensité et sa saleté. Ensuite nous retrouvons
Drakon/Dragon,Serpent : les photographies évoquent des mouvements ophidiens, des monstres de glace fossilisés. L’aspect dynamique y est important.

La troisième partie s’intitule
Petra/Pierre : cette partie révèle le cadre qui accueille le glacier, on y voit des volumes, on y devine du silence. L’avant dernière partie,
Hydro/Eau, laisse entrevoir les changements de la matière, l’eau, on l’entend couler au calme. Enfin, l’ultime chapitre s’intitule
Sperma/Semence. L’eau transmet ses vertus à la terre, de leur union naissent de petits parterres verts, de petites touffes perçant la roche et annonçant une vie prolifique en aval des sources de glace.
– Changer de regard LES AUTEURS NOUS MONTRENT DANS CET OUVRAGE QUE les montagnes et leurs glaciers sont des témoins privilégiés pour constater les blessures que l’humain a fait au monde. À l’image de ce dernier, elles fondent, se brisent et s’effondrent. Ils nous rappellent en même temps que ce sont les sources de la vie, elles abritent les glaciers, ces métronomes du vivant qui régissent le cycle de l’eau. Selon les auteurs, il est nécessaire d’opérer un changement profond et d’apprendre (ou de réapprendre) à vivre autrement, redevenir des enfants et recommencer notre apprentissage du monde. C’est un magnifique « objet-livre » qui est proposé ici. Il s’agit tout d’abord d’un bel objet : la couverture est texturée, les photos sont de bonne qualité, il est lisible : assez grand, il n’y a pas beaucoup de texte et ce dernier, structuré en différentes parties, n’est pas trop dense. C’est idéal pour aborder un sujet aussi brûlant. Il est composé de photographies en grand format, en particulier des Alpes ce qui est assez parlant pour des lecteurs français, en ce que cela fait écho à ce qu’ils connaissent. Il s’agit là d’un excellent ouvrage pour prendre conscience de la préciosité du monde.
–
Esther Fléty
-------------------------------
le 22 mai 2025
Les Sources de glace, Olivier de Sépibus, Nastassja Martin,
Editions Paulsen,
Mars 2025,
167 pages,
37 euros.
Crédit photos © Olivier de Sépibus

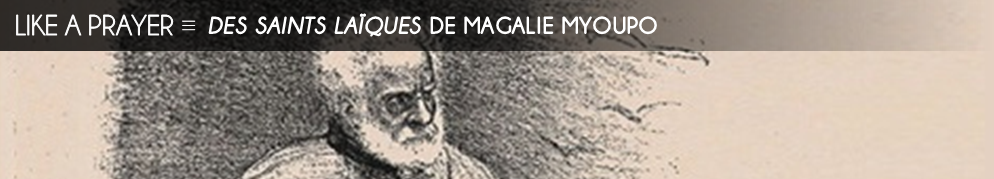



 La troisième partie s’intitule Petra/Pierre : cette partie révèle le cadre qui accueille le glacier, on y voit des volumes, on y devine du silence. L’avant dernière partie, Hydro/Eau, laisse entrevoir les changements de la matière, l’eau, on l’entend couler au calme. Enfin, l’ultime chapitre s’intitule Sperma/Semence. L’eau transmet ses vertus à la terre, de leur union naissent de petits parterres verts, de petites touffes perçant la roche et annonçant une vie prolifique en aval des sources de glace.
La troisième partie s’intitule Petra/Pierre : cette partie révèle le cadre qui accueille le glacier, on y voit des volumes, on y devine du silence. L’avant dernière partie, Hydro/Eau, laisse entrevoir les changements de la matière, l’eau, on l’entend couler au calme. Enfin, l’ultime chapitre s’intitule Sperma/Semence. L’eau transmet ses vertus à la terre, de leur union naissent de petits parterres verts, de petites touffes perçant la roche et annonçant une vie prolifique en aval des sources de glace.