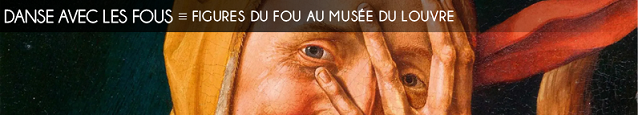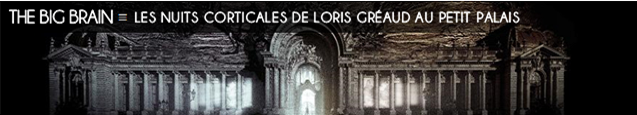CAR LE PARI EST AUDACIEUX, ET ENTRELACE PLUSIEURS QUESTIONNEMENTS : « Parce que le vêtement peut être une œuvre et qu’une œuvre peut être un vêtement, il est un langage à part entière que les artistes n’ont eu de cesse d’explorer jusqu’à aujourd’hui. » S’enchaînent alors des arrêts-sur-image élaborés comme des pensées, ou plutôt des variations sur un thème : comment l’artiste est-il/se pense-t-il au regard de la manière dont il est habillé/s’habille, d’une part, et comment l’histoire de la mode s’articule-t-elle à l’histoire de l’art ? L’ensemble commence de manière relativement « canonique ».  De l’artiste « fantasmé » – habillé à l’antique, comme dans l’Autoportrait de Constance Mayer-Lamartinière (1795-1801), en costume révolutionnaire, ou en habit de saint – avec la prégnance de la figure de Saint-Luc, par exemple chez Nicolas de Hoey en 1603 –, on passe à l’artiste « en représentation » – portraits d’académiciens du XVIIe siècle, artistes en chemise ou encore en costume noir, Un atelier aux Batignolles d’Henri Fantin-Latour (1870) ou l’Autoportrait de Francisco de Goya (1783) à l’appui.
De l’artiste « fantasmé » – habillé à l’antique, comme dans l’Autoportrait de Constance Mayer-Lamartinière (1795-1801), en costume révolutionnaire, ou en habit de saint – avec la prégnance de la figure de Saint-Luc, par exemple chez Nicolas de Hoey en 1603 –, on passe à l’artiste « en représentation » – portraits d’académiciens du XVIIe siècle, artistes en chemise ou encore en costume noir, Un atelier aux Batignolles d’Henri Fantin-Latour (1870) ou l’Autoportrait de Francisco de Goya (1783) à l’appui.
MAIS LA REFLEXION SE COMPLEXIFIE : L'AUTOPORTRAIT de Pierre Mignard (1690), témoin d’une époque où la mode s’impose comme outil de contrôle social, fait face à la collection « Le bal des artistes » de John Galliano en 2007 pour la maison Dior : portraits, autoportraits, le spectateur est invité à faire dialoguer représentations de soi et représentations de l’autre au moment-même où il pense la manière dont les artistes se pensent/sont pensés. Cet enrichissement du cheminement est explicite au moment où la question de l’artiste dans l’atelier met en regard Hyacinthe Rigaud (du peintre du même nom, 1692) et Prison du Peintre, une œuvre réalisée par des lycéens et étudiants en mode de la région Hauts-de-France.
–
Une réflexion innovante
PUIS S'OUVRE, DE MANIERE MOINS LINEAIRE SUR LE PLAN thématico-argumentatif, mais davantage comme une promenade à travers les questionnements, une série d’instantanés : le genre du vêtement – salle étonnante où sont mis en regard le Portrait de George Sand d’Eugène Delacroix (1834) et le Self-Portrait in Drag d’Andy Warhol (1980-1982) ou La Femme américaine libérée des années 70 de Samuel Fosso (1997) –, l’artiste en vêtement de travail
 – avec une méditation artistique autour de la blouse, du blouson et du bleu de travail, l’artiste en robe de chambre – la robe de chambre de Balzac par Auguste Rodin (1897), et tant d’autres. À noter, dans ce parcours, la salle « T’as le look coco ! », qui interroge certains stéréotypes (la marinière, notamment), au regard de l’humour et de l’autodérision des artistes eux-mêmes. Le clou du spectacle : l’extrait de Rigadin peintre cubiste, film muet de Georges Monca (1912), où Prince Rigadin s’habille en carton pour devenir, lui-même, un être « cubiste »…
– avec une méditation artistique autour de la blouse, du blouson et du bleu de travail, l’artiste en robe de chambre – la robe de chambre de Balzac par Auguste Rodin (1897), et tant d’autres. À noter, dans ce parcours, la salle « T’as le look coco ! », qui interroge certains stéréotypes (la marinière, notamment), au regard de l’humour et de l’autodérision des artistes eux-mêmes. Le clou du spectacle : l’extrait de Rigadin peintre cubiste, film muet de Georges Monca (1912), où Prince Rigadin s’habille en carton pour devenir, lui-même, un être « cubiste »…
ENFIN, LES DERNIERES SALLES DE L'EXPOSITION FONT PLUS PRECISEMENT DIALOGUER art et haute-couture, sous toutes ses formes. Les robes « simultanées » de Sonia Delaunay (1914), la robe « électrique » d’Atsuko Tanaka (Denkifuku, 1956), la robe serpent pour Niki de Saint Phalle (Marc Bohan, pour Christian Dior, 1982) : autant de postures où le vêtement devient performance et langage, au-delà-même de moyen d’expression de soi.  C’est d’ailleurs sur cette problématique que se clôt l’exposition : le vêtement pour dire une identité plurielle chez Léonard Foujita (Hanten bleu à motif de chrysanthèmes…, s.d.), créations-monde chez Yayoi Kusama (1969-), ou la mode pour un discours politique chez Vava Dudu (Amour caresse paix liberté, 2025).
C’est d’ailleurs sur cette problématique que se clôt l’exposition : le vêtement pour dire une identité plurielle chez Léonard Foujita (Hanten bleu à motif de chrysanthèmes…, s.d.), créations-monde chez Yayoi Kusama (1969-), ou la mode pour un discours politique chez Vava Dudu (Amour caresse paix liberté, 2025).
–
Des variations inspirantes
LES AMATEURS DE DIALOGUES ET DE COMPARATISMES y trouveront leur compte. Parce que l’exposition ne se veut pas strictement chronologique, on gagne à voir ensemble les autoportraits de Rembrandt (1660) et ceux de l’artiste franco-polonais Roman Opalka (1965-), qui se photographiait quotidiennement en noir et blanc, dans la même position, après chaque séance de travail. Idem pour le miroir offert, à partir de la couleur verte, entre Portrait de l’artiste d’Alexis Axilette (1907) et la veste Amour chewing-gum menthe de Vava Dudu (2025). Le veston noir semble même sortir des tableaux pour se matérialiser dans la salle d’exposition – tout comme l’avait fait, quelques pièces plus tôt, la robe blanche à l’antique. Les utilisations – propres à chaque artiste – du bleu de travail semblent se répondre plutôt que s’opposer, chacune donnant à voir des facettes de son potentiel artistique.
« S’HABILLER EN ARTISTE » EST AUSSI UNE EXPOSITION où la médiation culturelle trouve toute sa place. Les cartels sont extrêmement clairs, donnant à lire les clés de compréhension des œuvres – par exemple la contextualisation de la couleur rose pour le portrait de Guillaume I Coustou de Jean-François Delyen (1725). Les éléments sont contextualisés par des mises en regard, des parallèles, offrant à penser davantage qu’ils n’imposent un cheminement réflexif. On sort ainsi de la salle « T’as le look Coco ! » avec une appréciation autre des émoticônes « artistes », qu’on ne verra plus sous le même jour désormais.

FINALEMENT, L’UNE DES PLUS GRANDES REUSSITES de cette exposition est aussi celle d’avoir su nous habiller, nous, visiteurs, tout au long de notre réflexion sur le vêtement dans et par l’art : podiums, rideaux de velours, les Singing Sculpture (Gilbert & George, 1997) en fond sonore pendant une bonne moitié du parcours. Autant d’éléments intimistes qui protègent du monde extérieur pour laisser éclore l’une des expositions les plus stimulantes vues cette année.