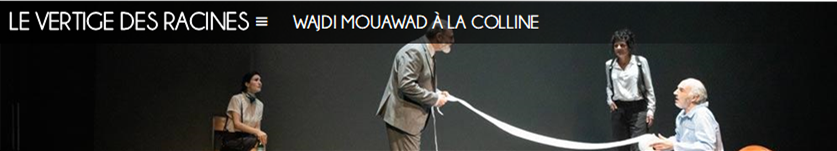SIX ANS APRES AVOIR MONTE LE SUICIDE de l'écrivain soviétique Nikolaï Erdman (1900-1970) à Berlin avec le Berliner Ensemble, dans un théâtre qui se trouvait, pendant la guerre froide, à Berlin-Est, Jean Bellorini revient avec sa pièce pour une tournée française et européenne (Villurbanne, Massy, Bobigny, La Rochelle, Compiègne, Marseille, Amiens, Budapest). Ecrite en 1928, interdite par les autorités soviétiques avant même d'avoir été jouée en 1932, Le Suicidé est une comédie éminemment complexe, se prêtant aux interprétations multiples. Et si en 2016, la pièce résonnait avec les attentats de 2015 à Paris - sur la thématique du martyr et autour des préoccupations du metteur en scène au Festival d'Avignon à propos des Frères Karamazov et du libre-arbitre -, ici l'idée était de repenser entièrement Le Suicidé à partir d'une nouvelle troupe et à l'aune du contexte actuel, à savoir la guerre à Ukraine.
–
Par Cécile Rousselet – Détresse moscovite DEVANT NOUS, UNE SCÈNE TRAGIQUE : Semione Semionovitch Podsekalnikov, sans emploi, « homme de trop[1] » soviétique, se suicidera, sans doute – c’est du moins ce qu’attend de lui son entourage. S’agitent autour de lui les différentes causes pour lesquelles il pourrait mettre fin à ses jours : l’intelligentsia, le commerce, l’art, l’amour, la religion. Chacune portée par un personnage allégorique haut en couleur, elles attendent, marchandent, achètent la mort du citoyen comme des billets de loterie, car, après tout : « Nous avons besoin de défunts idéologiques ». Tous cherchent à donner un sens à l’existence de Podsekalnikov – à sa vie par le travail, ou à sa mort. Les figures de cette comédie sordide sont, pour certaines, lugubres : Iegor Timofeïevitch porte à son plus haut degré l’esprit de délation qui sévissait en URSS à la fin des années 1920, les membres de l’orchestre errent sur la scène en habits militaires, et même les agents des pompes funèbres ont des airs de milice de la NKVD. Et puisque Podsekalnikov doit mourir (« Tuez-vous, si vous voulez, mais tuez-vous avec une conscience sociale. »), son salon devient le prétexte d’un défilé tragique des causes, mais surtout des désespoirs, et son dernier repas un règlement de comptes sur la Révolution. On ne cesse d’entrevoir, derrière les exclamations tourmentées des personnages, la vision cynique que Nikolaï Erdman, comme nombre de ses contemporains à l’instar de Panteleïmon Romanov, porte sur la société soviétique de son temps.
ET POURTANT, ON NE CESSE DE RIRE , PARFOIS MÊME AUX ÉCLATS. La belle-mère de Podsekalnikov, chauve en robe fleurie délavée, est désopilante. La scène d’apprentissage de l’hélicon, avec tout le potentiel comique que cet instrument représente, est proprement hilarante ; tout comme certaines répliques qui parviennent à réjouir le théâtre entier – Iegor Timofeïevitch,  par exemple, qui regarde Maria Loukianovna se laver les cheveux puis se défend de son voyeurisme par l’exclamation suivante : « Je la regardais d’un point de vue marxiste ». Une scène de comédie de mœurs aux détails tous plus cocasses les uns que les autres, mais dont la valeur comique n’a de sens que parce qu’ils s’inscrivent dans une intrigue elle-même risible : le suicidé refuse de se suicider. La comédie de mœurs mêle alors les genres : la saoulerie générale, regorgeant d’invectives contre la Révolution, est ponctuée par les « Quelle heure est-il ? » angoissés de Podsekalnikov, voyant approcher l’heure prévue de son trépas. La tonalité grave du théâtre de l’absurde s’entrelace à la dimension carnavalesque du texte, qui peut rappeler de grandes pages de Nikolaï Gogol, Andreï Biely ou plus proche d’Erdman, de Iouri Olecha.
par exemple, qui regarde Maria Loukianovna se laver les cheveux puis se défend de son voyeurisme par l’exclamation suivante : « Je la regardais d’un point de vue marxiste ». Une scène de comédie de mœurs aux détails tous plus cocasses les uns que les autres, mais dont la valeur comique n’a de sens que parce qu’ils s’inscrivent dans une intrigue elle-même risible : le suicidé refuse de se suicider. La comédie de mœurs mêle alors les genres : la saoulerie générale, regorgeant d’invectives contre la Révolution, est ponctuée par les « Quelle heure est-il ? » angoissés de Podsekalnikov, voyant approcher l’heure prévue de son trépas. La tonalité grave du théâtre de l’absurde s’entrelace à la dimension carnavalesque du texte, qui peut rappeler de grandes pages de Nikolaï Gogol, Andreï Biely ou plus proche d’Erdman, de Iouri Olecha.
EN EFFET, COMME DANS L’ENVIE (Olecha, 1927), publié l’année précédente, on retrouve le saucisson (ici, le saucisson de foie) en lieu et place des grands symboles tragiques et idéologiques. Il est la cause du suicide selon la belle-mère, remplace le revolver de Podsekalnikov, et traverse la pièce comme il traverse le plateau au tout début du spectacle. Car certainement, le potentiel comique de la pièce est extrêmement bien servi par des choix truculents de mise en scène. C’est un vaudeville que nous avons sous les yeux, mais un vaudeville très fin, qui accumule les clins d’œil cocasses à la force du texte d’Erdman. Tels, par exemple, plusieurs choix musicaux aussi pétillants qu’ingénieux : l’Intelligentsia, voulant créer un slogan de victoire à partir de la mort de Podsekalnikov, fredonne et s’agite, rougeaud, sur The Final Countdown d’Europe. Évocateur également est le titre d’Auld Lang Syne, chanson écossaise plus connue en français sous le nom de Ce n'est qu'un au revoir, presque murmurée par l’orchestre alors que l’heure du grand voyage a sonné pour le suicidé. – « Ce qu’un vivant peut penser, seul un mort peut le dire »
MAIS SUR LA SCÈNE DE LA MC93, LES ÉMOTIONS RESSENTIES ne sont jamais simples. On passe du rire aux larmes, au gré des entrelacs méandreux du parcours des personnages. Raïssa Filipovna et Cleopatra Maximovna nous enchantent quand elles s’indigent : « Ressuscitez l’amour, ressuscitez le romantisme » ; puis nous serrent le cœur par leur recherche désespérée d’affection. Et ces choix musicaux qui mettent le parterre hilare sont aussi ceux qui peuvent l’affliger par la violence qu’ils réinvestissent dans la pièce. Les chansons populaires, les polyphonies délicieuses aux basses tonitruantes, voire les extraits de techno russe, cohabitent avec les chants d’enterrement et les chœurs orthodoxes traditionnels. Et si la musique est un véritable protagoniste de la pièce, modulant les émotions des autres personnages comme celles de la salle, elle éclate en apothéose lorsque Podsekalnikov, ivre de la liberté que lui offre sa mort imminente, chante Creep à un microphone « Elvis », surnommé le « microphone tête de mort »… « C’que je veux, j’le fais » s’écrie le suicidé ; « What the hell am I doin' here? / I don't belong here » lui répond Radiohead.
CETTE ÉTRANGETÉ DU PERSONNAGE À SON ENVIRONNEMENT, sa solitude et son décalage, n’est pas seulement la conséquence d’une inadaptation soviétique. Certes, les références au contexte de l’URSS des années 1930 sont nombreuses, et invitent à réfléchir à cette période au-delà même du destin de Podsekalnikov. La Révolution est celle à qui on a tout donné, et dont on n’a rien reçu ; l’intelligentsia s’est faite avoir par le prolétariat comme une poule par les canetons qu’elle a couvés. L’irrévérence vis-à-vis des institutions et du pouvoir est totale, dans le texte, et dans la mise en scène qui le porte (la transe du pope orthodoxe, sur des basses de Deep House, est en cela assez remarquable).  Et, comme dans nombre de textes soviétiques de la même époque, les références christiques abondent, afin de signifier le sacrifice de toute une génération. Le dernier repas de Podsekalnikov, avec ses onze « causes » – et le marxiste, qui s’adjoint comme treizième convive – a des airs de Cène, les images finales rappellent une mise au tombeau, et la prétendue veuve Maria Loukianovna se fait prendre les mesures de sa robe d’enterrement les bras en croix. Images relativement traditionnelles, donc, pour la dramaturgie soviétique de l’époque. Mais s’ajoutent quelques références comiques (on pense à la belle-mère, qui tient son plateau telle une auréole) qui, quant à elles, dénotent et font l’originalité de la thématique ici exploitée.
Et, comme dans nombre de textes soviétiques de la même époque, les références christiques abondent, afin de signifier le sacrifice de toute une génération. Le dernier repas de Podsekalnikov, avec ses onze « causes » – et le marxiste, qui s’adjoint comme treizième convive – a des airs de Cène, les images finales rappellent une mise au tombeau, et la prétendue veuve Maria Loukianovna se fait prendre les mesures de sa robe d’enterrement les bras en croix. Images relativement traditionnelles, donc, pour la dramaturgie soviétique de l’époque. Mais s’ajoutent quelques références comiques (on pense à la belle-mère, qui tient son plateau telle une auréole) qui, quant à elles, dénotent et font l’originalité de la thématique ici exploitée. –
Carré blanc sur fond noir
LES SIGNIFICATIONS DE LA PIÈCE S’IMBRIQUENT, et comme des poupées russes, les sens à donner à ce « vaudeville soviétique » s’enchâssent les unes dans les autres. Jean Bellorini s’est employé à donner à l’ensemble une profondeur et des ramifications toujours plus subtiles, entreprise qui est mise en abyme par plusieurs choix scénographiques, dont le premier est l’usage de la vidéo. En effet, de la même manière que le texte d’Erdman joue sur plusieurs plans confondus (le suicide qui est en fait une saoulerie à la vodka), et que les interprétations possibles s’approfondissent et se répondent, la caméra retransmet en gros plan les expressions des visages – on reconnaît là des airs de films d’Ingmar Bergman, ou l’impressionnisme de Vsevolod Meyerhold, qui travailla avec Nikolaï Erdman dès 1925 –, créant des jeux de perspective, de hauteur et de pouvoir. Les personnages, Staline, Dieu et les spectateurs sont autant de voyeurs surplombant le suicidé qui se débat avec ses atermoiements.
UN DEUXIÈME NIVEAU S’ÉTABLIT : UNE RÉFLEXION « d’un point de vue philosophique » sur la vie et la mort, sur le « tic-pif » et « tac-paf » d’un canon de revolver, sur le temps qui sépare midi et midi et demi, et donc sur l’ontologie de l’instant entre la dernière seconde de vie et la première du néant. L’examen de l’après-la-mort et celle du tribunal pour « condamner à vivre » dépassent le cadre soviétique pour s’ancrer dans une interrogation métaphysique –  si Dostoïevski hantait la première mise en scène en raison des préoccupations de Jean Bellorini à la même époque, il ronge déjà Nikolaï Erdman, donnant à voir le devenir des angoisses existentielles de la Russie pré-révolutionnaire dans la littérature soviétique des années 1920. Et si Nadejda Mandelstam disait de la pièce : « C’est une pièce sur les raisons qui nous ont fait rester vivants alors que tout nous poussait au suicide. », n’est pas seulement inscrite en filigrane la dépressivité des personnages face aux évolutions de la Révolution sous les premières années staliniennes. L’expérience d’être-au-monde est ici interrogée, décortiquée sous le regard lugubre de ces nouveaux bourreaux soviétiques.
si Dostoïevski hantait la première mise en scène en raison des préoccupations de Jean Bellorini à la même époque, il ronge déjà Nikolaï Erdman, donnant à voir le devenir des angoisses existentielles de la Russie pré-révolutionnaire dans la littérature soviétique des années 1920. Et si Nadejda Mandelstam disait de la pièce : « C’est une pièce sur les raisons qui nous ont fait rester vivants alors que tout nous poussait au suicide. », n’est pas seulement inscrite en filigrane la dépressivité des personnages face aux évolutions de la Révolution sous les premières années staliniennes. L’expérience d’être-au-monde est ici interrogée, décortiquée sous le regard lugubre de ces nouveaux bourreaux soviétiques.
ENFIN S’ACCUMULENT LES SENS POSSIBLES DU DRAME qui se joue sous nos yeux – avec plus ou moins de subtilité. Podsekalnikov, le suicidé, se dresse en miroir du dramaturge Nikolaï Erdman, l’exilé et le sacrifié, comme en témoigne la projection de la lettre de Mikhaïl Boulgakov à Staline le 4 février 1938, pour défendre la cause de son compagnon de lettres. Il demeure quelques indices d’un premier travail sur la notion de martyr et de sacrifice après les attentats parisiens de 2015. Surtout, les derniers instants de la pièce font un parallèle entre les événements présentés et le suicide d’Ivan Petunin, rappeur russe qui s’est donné la mort le 30 septembre 2022 après l’appel à la mobilisation partielle en Russie pour la guerre en Ukraine. Acte de résistance, exposé tragique de la tension entre le bien collectif et les souffrances individuelles – il n’est pas de bonheur commun qui justifie la larme d’un seul être, Les Frères Karamazov sont encore là –, hommage ? Le sens donné à cette mise en perspective de la pièce souffre quelque peu de la brutalité avec laquelle la vidéo du discours d’Ivan Petunin est insérée dans le propos. Le hiatus ne pourra malheureusement pas être totalement comblé par le spectateur.
FINALEMENT, C’EST UNE RÉUSSITE que ce Suicidé dans sa mise en scène de 2022. Le suicidé ne se suicide pas, n’est pas suicidé non plus ; et résonnent en sortant ces mots, qui peut-être sont la clé de la mise en regard avec l’actualité ukrainienne : « Je veux vivre ».
C.R --------------------- le 22/02/2023
[1] L’ « homme de trop » est une notion russe magnifiée par Ivan Tourgueniev dans Le Journal d’un homme de trop (1850). Serge Rolet le définit comme « amputé de quelque chose : il est insensible ou aboulique, perdu dans ses réflexions, à l'écart du monde et des autres, incapable d'agir. » (in « Qui sont “l’homme de trop” et “le petit homme” ? », in Qu’est-ce que la littérature russe ? Introduction à la lecture des classiques (XIXe-XXe siècles), Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2019, p. 123-142, p. 123.
Le Suicidé, vaudeville soviétique,
Mise en scène de Jean Bellorini,
à partir du texte de Nicolaï Erdman
Février 2022
à la MC 93 Plus d'informations ici Crédits Photos © : Juliette Parisot

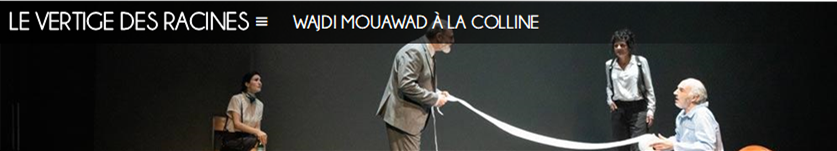


 par exemple, qui regarde Maria Loukianovna se laver les cheveux puis se défend de son voyeurisme par l’exclamation suivante : « Je la regardais d’un point de vue marxiste ». Une scène de comédie de mœurs aux détails tous plus cocasses les uns que les autres, mais dont la valeur comique n’a de sens que parce qu’ils s’inscrivent dans une intrigue elle-même risible : le suicidé refuse de se suicider. La comédie de mœurs mêle alors les genres : la saoulerie générale, regorgeant d’invectives contre la Révolution, est ponctuée par les « Quelle heure est-il ? » angoissés de Podsekalnikov, voyant approcher l’heure prévue de son trépas. La tonalité grave du théâtre de l’absurde s’entrelace à la dimension carnavalesque du texte, qui peut rappeler de grandes pages de Nikolaï Gogol, Andreï Biely ou plus proche d’Erdman, de Iouri Olecha.
par exemple, qui regarde Maria Loukianovna se laver les cheveux puis se défend de son voyeurisme par l’exclamation suivante : « Je la regardais d’un point de vue marxiste ». Une scène de comédie de mœurs aux détails tous plus cocasses les uns que les autres, mais dont la valeur comique n’a de sens que parce qu’ils s’inscrivent dans une intrigue elle-même risible : le suicidé refuse de se suicider. La comédie de mœurs mêle alors les genres : la saoulerie générale, regorgeant d’invectives contre la Révolution, est ponctuée par les « Quelle heure est-il ? » angoissés de Podsekalnikov, voyant approcher l’heure prévue de son trépas. La tonalité grave du théâtre de l’absurde s’entrelace à la dimension carnavalesque du texte, qui peut rappeler de grandes pages de Nikolaï Gogol, Andreï Biely ou plus proche d’Erdman, de Iouri Olecha. Et, comme dans nombre de textes soviétiques de la même époque, les références christiques abondent, afin de signifier le sacrifice de toute une génération. Le dernier repas de Podsekalnikov, avec ses onze « causes » – et le marxiste, qui s’adjoint comme treizième convive – a des airs de Cène, les images finales rappellent une mise au tombeau, et la prétendue veuve Maria Loukianovna se fait prendre les mesures de sa robe d’enterrement les bras en croix. Images relativement traditionnelles, donc, pour la dramaturgie soviétique de l’époque. Mais s’ajoutent quelques références comiques (on pense à la belle-mère, qui tient son plateau telle une auréole) qui, quant à elles, dénotent et font l’originalité de la thématique ici exploitée.
Et, comme dans nombre de textes soviétiques de la même époque, les références christiques abondent, afin de signifier le sacrifice de toute une génération. Le dernier repas de Podsekalnikov, avec ses onze « causes » – et le marxiste, qui s’adjoint comme treizième convive – a des airs de Cène, les images finales rappellent une mise au tombeau, et la prétendue veuve Maria Loukianovna se fait prendre les mesures de sa robe d’enterrement les bras en croix. Images relativement traditionnelles, donc, pour la dramaturgie soviétique de l’époque. Mais s’ajoutent quelques références comiques (on pense à la belle-mère, qui tient son plateau telle une auréole) qui, quant à elles, dénotent et font l’originalité de la thématique ici exploitée. si Dostoïevski hantait la première mise en scène en raison des préoccupations de Jean Bellorini à la même époque, il ronge déjà Nikolaï Erdman, donnant à voir le devenir des angoisses existentielles de la Russie pré-révolutionnaire dans la littérature soviétique des années 1920. Et si Nadejda Mandelstam disait de la pièce : « C’est une pièce sur les raisons qui nous ont fait rester vivants alors que tout nous poussait au suicide. », n’est pas seulement inscrite en filigrane la dépressivité des personnages face aux évolutions de la Révolution sous les premières années staliniennes. L’expérience d’être-au-monde est ici interrogée, décortiquée sous le regard lugubre de ces nouveaux bourreaux soviétiques.
si Dostoïevski hantait la première mise en scène en raison des préoccupations de Jean Bellorini à la même époque, il ronge déjà Nikolaï Erdman, donnant à voir le devenir des angoisses existentielles de la Russie pré-révolutionnaire dans la littérature soviétique des années 1920. Et si Nadejda Mandelstam disait de la pièce : « C’est une pièce sur les raisons qui nous ont fait rester vivants alors que tout nous poussait au suicide. », n’est pas seulement inscrite en filigrane la dépressivité des personnages face aux évolutions de la Révolution sous les premières années staliniennes. L’expérience d’être-au-monde est ici interrogée, décortiquée sous le regard lugubre de ces nouveaux bourreaux soviétiques.