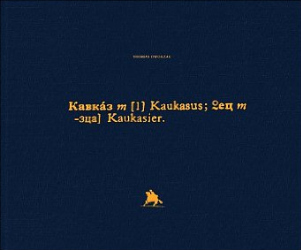Thomas Dworzak : explosion sur papier glacé
Les bombes pleuvent, le sol tremble, la vitre se brise dans le souffle des explosions. Aux murs, la surface des photographies crève, et leurs sujets s'échappent. A l'occasion de la parution du livre du photoreporter Thomas Dworzak chez Schilt Publishing, intitulé Kavkas, la Magnum Gallery, à Paris, expose une série d'images capturées dans le Caucase entre 1993 et 1998 par le photographe allemand.
Le bombardement a cessé, ne reste qu'un champ de ruines. Les murs en noir et blanc sont criblés d'éclats de balles, lardés de trous d'obus, vérolés par les plombs propulsés des shrapnels, là où le métal sifflant tiré des canons tchétchènes a frappé de plein fouet leurs vieux pans grumeleux. Au nord, le cadavre tordu d'une maison détruite vomit son tas de briques entre des dents rouillées. A l'est, une rue entière a été rasée, ses immeubles crevés exposant ça et là des squelettes branlants garnis de chairs percées. Au sud, les balcons déchirés des hôtels pour plagistes font dorer au soleil leurs armatures tordues. Pierres, briques, graviers, moellons jonchent le sol de toute part. Les routes sont explosées. De l'Ossétie du Nord à la Géorgie, de la Tchétchénie à l'Ingouchie, le Caucase est détruit. Où que l'œil se pose, d'un coin à l'autre de la galerie, le paysage est rugueux, rude, âpre. Pas seulement à cause des guerres : dans cette région du monde, le brut et le calleux priment. Derrière les bâtiments éboulés s'élève une chaine de hautes montagnes en ruines, aux sommets irréguliers, aux flancs couverts d'aspérités ; à ses pieds gisent les mêmes gravats que dans la ville détruite et, là où les maisons se tiennent encore debout, on voit que ces rochers forment leurs murs trapus. Autour, dans la campagne, s'étirent des champs de

rocailles, aux meules de gros foin assez rêches pour blesser, traversées de rivières aux eaux aussi dures que celles des flaques citadines qui miroitent grassement dans les ornières d'obus. Et plus loin encore, là où sévit l'hiver géorgien, la neige est grise et granuleuse. Seules les silhouettes se fondent, en trainant un cadavre.
Sur des rectangles de papier glacé, le photographe Thomas Dworzak impose, à la craie et au fusain, des décors sombres aux textures de toile émeri. Lorsque son arrière-plan, droit ou penché, est rempli à faire exploser les bords de son image, il place des personnages dont les visages sont rarement offerts de pleine face. Leurs objets occupent en revanche une place dominante. Des tissus, d’abord. Les étoffes noires et fanées des longues robes des femmes, piquées de fleurs claires, les carreaux chiffonnés des chemises des civils, les chapkas à gros grains sur leurs têtes en hiver, les plis fatigués des uniformes des soldats, les motifs géométriques des tapis de lainage poussiéreux disposés pour un mariage. Partout également, taillés dans les mêmes matériaux grenus, des véhicules âgés et des kalachnikovs montrent une modernité fatiguée parmi cette profusion de détails empreints de tradition. Ici, les armes luisantes parent les épaules d'un groupe de ménagères. Leurs têtes sont couvertes de voiles et leurs traits ne sont visibles qu'à demi, de profil, dissimulés derrière un élément de décor ou coupés par le cadre de la photo. Leurs sourcils épais se froncent sur des nez busqués, solides, au-dessus de bouches qui sourient rarement. Plus loin, les visages de trois anciennes sont coupés en quartiers par de longues balafres suintantes. Deux autres vieilles en noir, ridées comme des vieilles pommes, attendent, impassibles, devant un barrage routier, de pouvoir rentrer chez elles. Quelques femmes seulement tiennent des enfants par la main, souvent des petites filles aux regards sombres. Les hommes, aux traits bruns, ne sont guères plus expressifs. Qu'ils soient Tchétchènes ou Géorgiens, soldats en faction ou civils parmi des ruines, moines orthodoxes ou patrons d'un café à moitié détruit, la plupart arborent des visages déterminés - jusqu'à ce que l'un d'eux, un milicien en uniforme, enfouisse sa tête dans ses mains et pleure. Tout n'est cependant pas martial : derrière les traces évidentes de guerre et de combat, on voit surgir des éléments de la vie quotidienne et des mentalités caucasiennes.
Les clichés de Thomas Dworzak sont saturés d'énergie ; oeil du photographe ? Réalité des sujets ? Les deux ? D'un bout à l'autre de la galerie, deux personnages seuls dans leurs images, et d'une facture un peu différente, observent en silence ce théâtre en action. La première est une vieille dame assise de profil, maquillée d'un trait soigné de khôl et coiffée d'un élégant bonnet de soirée. Elle ressemble à une maîtresse de ballet russe jugeant de loin, d'un œil sévère et concentré, une représentation dont elle ne peut entièrement s'abstraire. Son visage reçoit toute la lumière de la scène, sa suite disparaît dans l'obscurité. Le second observateur, proche de l’entrée de la galerie, est un jeune homme en uniforme de Cosaque. Son double - son reflet - se tient à ses cotés, un peu en retrait. Les moitiés gauches de leurs deux visages identiques sont perdus dans l'ombre. Sous ce portrait est inscrit, sur le mur de la galerie, une citation de l'écrivain russe Mikhail

Lermontov (1814-1841), connu comme "le poète du Caucase", tirée du roman
Un Héros de notre Temps : "
Sa venue au Caucase est aussi la conséquence de son fanatisme romantique : je suis sûr qu'à la veille de son départ du village paternel, il disait, l'air sombre, à quelque jolie voisine, qu'il n'allait pas simplement servir l'armée, mais qu'il cherchait la mort, parce que…"
De qui parle-t-on dans cet extrait choisi personnellement par le photographe ? Thomas Dworzak n'est pas caucasien. Né en 1972 en Allemagne, le photographe grandit dans un village de la forêt bavaroise qu'il quitte à vingt ans pour explorer avec son objectif l'Espagne, la République Tchèque et enfin la Russie, dont il apprend la langue et découvre la littérature. Son arrivée à Tbilissi, en Géorgie, en 1993, est le fruit du hasard. Il ne pense y rester que quelques mois mais tombe sous le charme du Caucase et ne le quitte qu'en 1998, en conservant toutefois une résidence à Tbilissi. "
J'ai découvert le Caucase sans préjugés, raconte-t-il.
L'hospitalité de ses habitants. La beauté de ses langues. Les changements incroyablements rapides survenus après la chute de l"Union Soviétique. Les guerres et les conflits, le courage et la cruauté. Ce territoire de contrastes peut provoquer des émotions extrêmes ; il me fascine et me bouleverse." La série de clichés exposés par Magnum est le résultat de cinq ans d'immersion dans cette région étrangère qu'il a faite sienne.
"
Thomas Dworzak est un reporter, mais ici, il ne s’agit pas exactement de photojournalisme, précise Valérie Fougeirol, directrice artistique de la galerie
. La plupart de ces clichés n'ont pas été diffusés dans la presse. Dans le Caucase, Thomas Dworzak a trouvé le fil de ce qu'il souhaitait exprimer en photographie. C'est un travail profondément personnel." C'est pourquoi la trentaine d'images suspendues aux murs de la galerie ne sont pas légendées. Le brouillard spatio-temporel renforce la dimension irréelle : impossible de retrouver les fils de l'histoire caucasienne récente avec ces seules images, de comprendre dans ces photographies qui est Russe ou Tchétchène, quelle ville vient d'etre bombardée, de quelle année il s'agit. Les épreuves, réunies en séries de quatre ou cinq, sont accompagnée de citations tirées de la littérature russe ou caucasienne :
Les Cosaques de Léon Tolstoi, ou
Voyage à Arzroum d'Alexandre Pouchkine. Si certains propos éclairent les images, d'autres agissent en énigme, ne faisant qu'épaissir cette inquiétante étrangeté qui se déploie dans la galerie silencieuse, sous les yeux du jeune homme et de la vieille danseuse.
 rocailles, aux meules de gros foin assez rêches pour blesser, traversées de rivières aux eaux aussi dures que celles des flaques citadines qui miroitent grassement dans les ornières d'obus. Et plus loin encore, là où sévit l'hiver géorgien, la neige est grise et granuleuse. Seules les silhouettes se fondent, en trainant un cadavre.
rocailles, aux meules de gros foin assez rêches pour blesser, traversées de rivières aux eaux aussi dures que celles des flaques citadines qui miroitent grassement dans les ornières d'obus. Et plus loin encore, là où sévit l'hiver géorgien, la neige est grise et granuleuse. Seules les silhouettes se fondent, en trainant un cadavre.  Lermontov (1814-1841), connu comme "le poète du Caucase", tirée du roman Un Héros de notre Temps : "Sa venue au Caucase est aussi la conséquence de son fanatisme romantique : je suis sûr qu'à la veille de son départ du village paternel, il disait, l'air sombre, à quelque jolie voisine, qu'il n'allait pas simplement servir l'armée, mais qu'il cherchait la mort, parce que…"
Lermontov (1814-1841), connu comme "le poète du Caucase", tirée du roman Un Héros de notre Temps : "Sa venue au Caucase est aussi la conséquence de son fanatisme romantique : je suis sûr qu'à la veille de son départ du village paternel, il disait, l'air sombre, à quelque jolie voisine, qu'il n'allait pas simplement servir l'armée, mais qu'il cherchait la mort, parce que…"