L'esprit du corps
Pierre-Emmanuel Sorignet livre dans une enquête, qu'il annonce lui-même comme ethnographique, le fruit de plusieurs années de recherches et de réflexions sur les terrains de la danse. Danser, enquête dans les coulisses d'une vocation est l'un des rares ouvrages à interroger le parcours de danseurs et de danseuses professionnelles par le prisme d'entretiens individuels, c'est-à-dire en valorisant l'écoute et le sensible quand la majeure partie des parutions d'ouvrages sur la danse, en-dehors des monographies, se fonde essentiellement sur les résultats d'enquêtes quantitatives commanditées le plus souvent par le Ministère de la Culture et de la Communication et menées par des experts comme les agents de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
L'enquête de Pierre-Emmanuel Sorignet a duré près
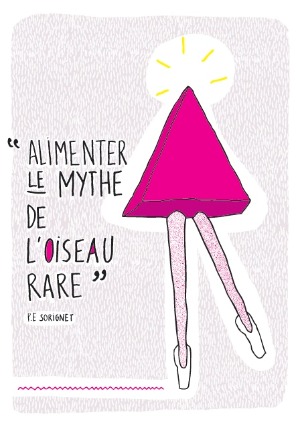
de douze ans, durant lesquels il a mené une centaine d'entretiens conséquents avec une trentaine de témoins qui forment ce qu'il appelle son "noyau dur". Lui-même danseur, compagnon d’une danseuse, Sorignet a sur le métier et sur le milieu de la chorégraphie contemporaine un oeil de professionnel et de praticien, s'inscrivant de ce fait dans la grande tradition de l'ethnographie participante. Il défend l'idée selon laquelle, pour interroger un milieu, il faut s'y fondre, rejoignant ainsi les méthodes de Claude Levi-Strauss dans son travail sur les Amérindiens ou, plus proche de nous encore, de Gayle Rubin auprès des communautés sexuelles dans le San Francisco des années 1970. Trois approches qui tentent de faire tomber les clichés, de déjouer les méconnaissances et de mieux donner à voir, donc à comprendre, des groupes sociaux peu connus.
Naissance du désir : vocation et milieu
Comment naît le désir de la danse ? Quels sont les terrains qui prédisposent à l'entrée dans un milieu dont on imagine sans peine la dureté et le peu de solidité professionnelle et financière ? "
J'ai toujours su que je serais danseuse, pour moi je ne voyais pas autre chose", indique ainsi Laure, 35 ans, qui danse depuis 15 ans. Et c'est, peu ou prou, ce que chaque artiste qu'a interrogé Pierre-Emmanuel Sorignet répond. Peu importe le milieu social dont ils sont originaires, la formation reçue ou l'âge d'entrée dans le circuit professionnel, il semblerait que cette envie de danser soit ancrée dès leur plus jeune âge pour les danseurs.
Quel que soit le style de danse - classique, contemporaine, hip-hop ou ethnique - les artistes sont issus, pour une grande part, du milieu dit des professions supérieures, illustrant ainsi les idées de Pierre Bourdieu sur la distinction de classe et sur la reproduction sociale. Selon Sorignet, ces milieux, considérés comme plus cultivés et plus sensibles à l'oeuvre chorégraphique, fréquentent tout simplement davantage les lieux où l'on programme de la danse et sont par conséquent plus enclins à préparer et à aider leurs enfants à vivre "une vie d'artiste". Cependant, certaines familles peuvent considérer comme un déclassement social le fait de voir leur enfant devenir un artiste. Et dans les milieux populaires, en raison de la méconnaissance de ce type de parcours et des stéréotypes bien ancrés, comme l'homosexualité pour les garçons et l'image de la vie de bohème, les parents s'opposent souvent à l'envie et au projet de carrière de leur enfant. Et en dehors de la famille, les enseignants sont aussi essentiels dans la découverte de la danse et l'aspiration à entrer dans cette voie.
 Danser et faire danser aujourd'hui
Danser et faire danser aujourd'hui
Les années 1980 ont marqué "l'âge d'or" de la subvention par l'Etat de la Culture. Sous l'impulsion de Jack Lang, qui avait fait découvrir au public du Festival de Nancy de grands chorégraphes, à l'instar de
Pina Bausch, des Centres Chorégraphiques Nationaux sont créés sur tout le territoire. C'est dans ces lieux, construits autour de la figure du chorégraphe qui les dirige, que se développe ce que l'on appelle encore aujourd'hui la nouvelle danse française. On assiste à une professionnalisation de plus en plus grande, entre autres, en raison du passage presque obligé aujourd'hui par des grandes écoles de la danse comme le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMDP) ou par des Centre Nationaux de Danse Contemporaine. Aujourd'hui, dans les grandes compagnies subventionnées, les chorégraphes vont jusqu'à pré-sélectionner les interprètes sur CV. Les moyens de productions ont en effet baissé, et ne cessent de le faire, depuis des années. Il faut alors trouver des interprètes capables de manier si possible un autre art que la danse, comme le cirque, le chant ou le théâtre, prêts sur le champ, et qui ont l'habitude de s'adapter à l’esthétique d'un artiste-chorégraphe en peu de temps, pour que les compagnies puissent commencer rapidement les répétitions et ne pas perdre de temps et d'argent.
Le statut d'intermittent, et surtout sa remise en question par les lois de 2003, ont aussi profondément bouleversé la manière dont les artistes chorégraphiques investissent le métier. Le statut d'intermittent est, pour les plus jeunes, la preuve de l'entrée dans le métier, une forme de reconnaissance sociale et professionnelle de leur parcours, et pour les plus "vieux" la condition
sine qua non du maintien dans la profession. Ce statut est la chance donnée à chacun de pouvoir prendre des cours, maintenir un niveau optimal de technique mais aussi de tout simplement pouvoir se déplacer pour passer des auditions. La perte du statut est souvent le premier pas vers une sortie du métier. Or, avec le durcissement des lois, il devient de plus en plus difficile à obtenir. Pourtant, la danseuse Marjorie explique à l'auteur qu'elle ne veut pas toucher les ASSEDIC afin de pouvoir vivre son art sans contrainte, sans courir après les cachets. Nombre de danseurs ou de chorégraphes ont également préféré quitter les CCN où ils travaillaient pour revenir à une vie de compagnie qui les expose davantage à l'instabilité financière mais leur permet aussi de créer plus librement. Par nécessité économique, les danseurs ne peuvent pas toujours se contenter de travailler pour des chorégraphes qu'ils aiment et qu'ils respectent. Comment dès lors s'impliquer dans ces productions ? Les danseurs se sentent-ils plutôt "exécutants ou interprètes" ?, demande Sorignet. Antoine, désabusé, dit ne pas se sentir artiste mais plutôt employé. Ici, c'est le corps social de l'artiste qui est donc interrogé, sa place sur le marché du travail.
Primat du chorégraphe
Dès lors la figure de chorégraphe apparaît primordiale, comme artiste démiurge ou comme simple patron. L'auteur dresse le portrait du chorégraphe en chef d'entreprise aux prises avec les pouvoirs publics, les programmateurs et les experts de la DRAC. Pour la plupart, les danseurs interrogés "tirent leur chapeau" au chorégraphe qui mène à bien ces tractations. Le chorégraphe est le levier du projet, aussi bien d'un point de vue artistique que financier, mais il est aussi fédérateur de plusieurs corps de métiers et de plusieurs artistes interprètes. Les danseurs espèrent voir en lui un "maître" ou du moins un pédagogue. Témoin, Pina Bausch, qui apparaît comme une figure modèle, elle qui prend la liberté de tout changer jusqu'au dernier moment et ne donne parfois les déroulés de ses pièces qu'en coulisses, le soir de la première.
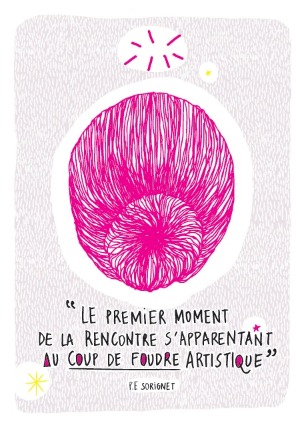
Mais se pose, justement, la question de la suprématie du chorégraphe, notamment dans son rapport au corps des danseurs. Il s'agit, pour ces derniers, de "s'incorporer", pour reprendre le terme de Sorignet, au vocabulaire du chorégraphe, ce qui est parfois ressenti comme une perte de leur identité. Il faut passer, pour que le spectacle prenne forme, de l'intime de la danse, de son corps au collectif - ce que l'on nomme "corps de ballet". Ne faire plus qu'un avec celui qui opère les choix artistiques, même s'il se nourrit des improvisations de ses interprètes. Cette forme de soumission ne va pas sans tension,
a fortiori parce qu'il n'existe pas de formation de chorégraphes en France, de même d'ailleurs que pour les metteurs en scène. Et puisqu'il s'agit plutôt d'auto-proclamation, les choix s'exposent à être, parfois, remis en cause.
Vivre la danse
Quelle est la vie du danseur lorsqu'il ne danse pas ? Quels sont les impacts de la danse sur la vie sociale, amoureuse ou familiale ? Elle est faite de moments très forts, comme ceux de la création et des tournées, mais aussi du vide des intervalles entre deux projets. Les moments de création paraissent à bien des interprètes en dehors de la réalité. Ils se coupent du reste du monde. La vie de tournée, ou en résidence de création, loin de chez soi, rend difficile une vie affective stable. Cependant, une partie du panel interrogé conçoit aussi que cela fait partie du métier et n'aimerait pas forcément que leur compagnon ou compagne ait la même pratique. Devenir parent devient aussi une vraie question, surtout pour les femmes, dans leur vie d'interprète. Sorignet note que la plupart des femmes interrogées deviennent mères lorsqu'elles parviennent au point d'orgue de leur carrière. Se sentant "
jeune maman mais vieille danseuse", une partie non négligeable des interprètes - mais il en est de même pour les hommes - cessent de papillonner de compagnie en compagnie pour ne plus choisir que des créations qui "valent la peine" de moins voir leur enfant pendant un long moment.
Sorignet affronte aussi les préjugés et les stéréotypes autour de la danse. Pour beaucoup des interrogés, il est évident que la plus grande tolérance dont fait preuve le milieu de la danse face à l'orientation homosexuelle a beaucoup joué dans le choix de s'investir dans la carrière. Mais pour certains des danseurs, c'est au contraire la danse, la liberté de mouvement et surtout la relation plus intime des corps qui permet de découvrir une réalité longtemps cachée à soi-même. L'auteur revient ainsi sur le déplacement des injonctions genrées qu'engendre la pratique de la danse : le corps de l'homme danseur évoque à la fois une forme de perfection proche des canons de beauté grecque mais aussi une forme non violente dans le rapport au corps féminin puisqu'il participe avec elle à la création d'une beauté raffinée.
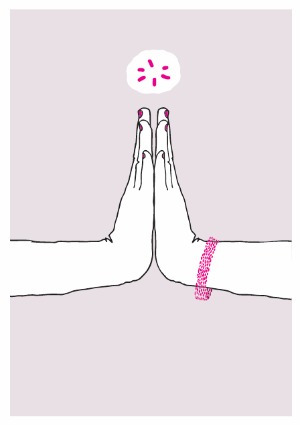 Trahisons du corps, désillusions de la vocation
Trahisons du corps, désillusions de la vocation
Le fil conducteur de l'ouvrage de Pierre-Emmanuel Sorignet est sans nul doute le corps. Pour un danseur, cette question est capitale puisque c'est son instrument de travail : un corps modelé par des années de technique, rompu à l'exercice de la barre, souffrant jusqu'au martyre pour réussir tel enchaînement ou telle figure, mais aussi inscrit dans une société. Un corps qui désire, qui est désiré et qui vieillit. Qu'en est-il de la sortie du métier ? Les corps ne répondent plus à la demande des chorégraphes. Au corps obéissant, admiré sur la scène, succède le corps vieillissant, qui n'obéit plus à la vocation, aux désirs de vie et aux exigences du métier. Souvent aussi, face à la cruauté du milieu, la vocation semble s'éroder. Cette érosion souvent due à la lassitude de vivre avec des moyens assez bas, au fait de ne plus supporter - beaucoup d'entre eux en témoignent - les caprices des chorégraphes mais aussi à la concurrence, lors des auditions avec des jeunes qui entrent dans le milieu, pour renouveler un cycle perpétuel de corps qui se succèdent.
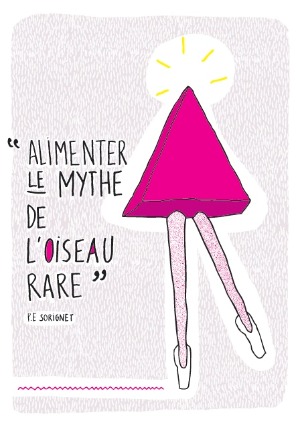 de douze ans, durant lesquels il a mené une centaine d'entretiens conséquents avec une trentaine de témoins qui forment ce qu'il appelle son "noyau dur". Lui-même danseur, compagnon d’une danseuse, Sorignet a sur le métier et sur le milieu de la chorégraphie contemporaine un oeil de professionnel et de praticien, s'inscrivant de ce fait dans la grande tradition de l'ethnographie participante. Il défend l'idée selon laquelle, pour interroger un milieu, il faut s'y fondre, rejoignant ainsi les méthodes de Claude Levi-Strauss dans son travail sur les Amérindiens ou, plus proche de nous encore, de Gayle Rubin auprès des communautés sexuelles dans le San Francisco des années 1970. Trois approches qui tentent de faire tomber les clichés, de déjouer les méconnaissances et de mieux donner à voir, donc à comprendre, des groupes sociaux peu connus.
de douze ans, durant lesquels il a mené une centaine d'entretiens conséquents avec une trentaine de témoins qui forment ce qu'il appelle son "noyau dur". Lui-même danseur, compagnon d’une danseuse, Sorignet a sur le métier et sur le milieu de la chorégraphie contemporaine un oeil de professionnel et de praticien, s'inscrivant de ce fait dans la grande tradition de l'ethnographie participante. Il défend l'idée selon laquelle, pour interroger un milieu, il faut s'y fondre, rejoignant ainsi les méthodes de Claude Levi-Strauss dans son travail sur les Amérindiens ou, plus proche de nous encore, de Gayle Rubin auprès des communautés sexuelles dans le San Francisco des années 1970. Trois approches qui tentent de faire tomber les clichés, de déjouer les méconnaissances et de mieux donner à voir, donc à comprendre, des groupes sociaux peu connus.  Danser et faire danser aujourd'hui
Danser et faire danser aujourd'hui 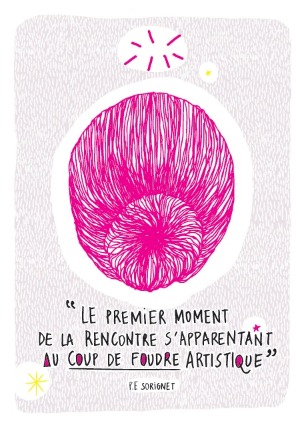
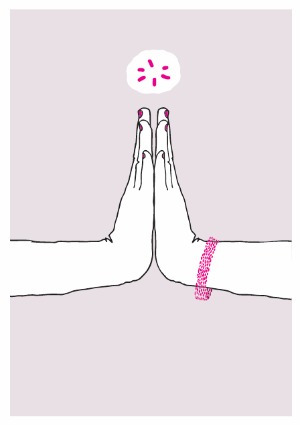 Trahisons du corps, désillusions de la vocation
Trahisons du corps, désillusions de la vocation