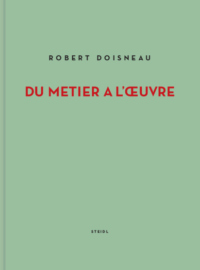Robert Doisneau recadré
Pour sa première exposition de l’année, la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris invite Robert Doisneau (1912-1994), un Doisneau qui sort des sentiers battus. Le fameux Baiser de l’Hôtel de ville, accroché, fait presque figure d'anecdote dans un corpus qui évite, une fois n’est pas coutume, les clichés. Petite ceinture et petites gens… L’autre face, moins mièvre, plus complexe, d’un promeneur infatigable davantage attaché à l’émotion qu’au bonheur. Du métier à l’œuvre est le titre de cette exposition qui se propose de "regarder Doisneau autrement", selon la formule d’Agnès Sire, la directrice de la Fondation.
Jean-Claude Gautrand n’en revient pas. A 77 ans, ce photographe, qui a fondé entre autres le groupe Gamma en 1963, ne pensait pas découvrir encore aujourd’hui des images de Doisneau inconnues. Et de pointer, du haut de sa haute silhouette chenue,
Le marché Saint-Honoré (1945),
Camouflage, prise la même année, ou encore cette très belle photographie, de saison,
Prêtre ouvrier (1951) sur laquelle on aperçoit, dans le lointain, sur une route légèrement pentue, au beau milieu d’une campagne enneigée, vide et donc un peu hostile, un homme en soutane tenter de pousser une roulotte récalcitrante. Et si l’œil expert du photographe professionnel se déclare émerveillé par cette sorte de cadeau, il faut aussi entendre son enthousiasme de voir enfin le Doisneau "
désenchanté", du temps où il arpentait Paris, certes, mais surtout la banlieue.
Cachan, Nogent, Puteaux, Alfortville, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Choisy-le-Roi, Saint-Denis et bien sûr Gentilly, là où tout a commencé par un beau jour de printemps 1912… Voici en effet, non exhaustive, la liste des communes qui constituent les étapes de prédilection de celui qui n’a jamais cessé de tourner, à vélo ou à pied, de jour comme de nuit, autour de Paris. C’est cette géographie particulière et quasi inédite pour l’époque - "
Peu de photographes se sont intéressés à la banlieue dans ces années-là", indique Agnès Sire - que l’exposition nous invite à redécouvrir à travers une centaine d’images. Dont la toute première, prise en 1929, où s'éparpissent des pavés sur une chaussée bancale, défoncée ; ces pavés tristes que Doisneau allait commencer à battre dès l’année

suivante de sa semelle d’arpenteur partagé entre onirisme et réalisme. Les deux photographies qui, en guise de préambule, succèdent aux
Pavés donnent en effet le ton : côte à côte,
La chambre de Gentilly (1930) où il vit et qui, avec ses rideaux brodés, son papier-peint fleuri et ses meubles "de famille", respire le confinement, l’ennui, la réclusion, et
Le nez au carreau (1953), image prise rue Pajol à Paris et sur laquelle on peut voir une fillette debout sur une table scrutant la rue, l’extérieur, l’inconnu, à travers la vitrine d’un café. Un raccourci qui dit bien la nécessité vitale pour Robert Doisneau qui "
exécrait le milieu petit-bourgeois" de s’échapper, de passer de l’autre côté de la fenêtre.
Et celui qui fut tour à tour graveur, opérateur, dessinateur de lettres et photographe industriel aux usines Renault à Billancourt (jusqu’à ce que ses retards répétés ne se soldent par un renvoi, en 1939) est toujours resté fidèle à ses convictions de communiste, préférant la compagnie des acrobates de l’existence aux gens du spectacle ou de la mode. On ne s’étonnera donc pas de croiser tant d’enseignes de bistrot comme autant de phares dans une vie parfois peu avenante, ces impérissables "Au bon coin" qui, d’angles en façades, ont dessiné à travers tout l’Hexagone une véritable topologie de l’espoir réinventé et d’une convivialité façon "serrons-nous les coudes" à l’ombre des barres de HLM qui, juste derrière le fragile rempart constitué par les petites habitations de guingois, poussent inexorablement leur ombre impersonnelle et boulimique. Car c’est bien ainsi que ces doux noms surgissent dans la grisaille, la misère, la solitude de cette zone (déjà...) souvent blafarde et triste. Qui aurait envie de faire la course avec cet homme poussant son vélo, épaules rentrés et col d’imper remonté, sous une pluie fine peut-être mais que l’on devine froide et pénétrante (
Cycliste en banlieue, 1949) ?
Rien néanmoins de misérabiliste ni de dramatique. Il y a même souvent, surgi de ce monde un peu gris et las, une présence insolite, un objet inattendu qui, l’une comme l’autre, font battre à nouveau les cœurs : on pense, par exemple, aux deux photographies intitulées l’une,
Le mimosa du comptoir (1952), posé sans doute par hasard entre un homme et une femme comme au bout du rouleau, et l’autre,
Les Bouchers mélomanes (1953) sur laquelle ceux que l’on appelait alors les forts des Halles, abandonnant un instant le petit blanc sur le comptoir, prêtent une oreille attentive et fort respectueuse à une accordéoniste dénommée Pierrette D’Orient, que l’on retrouvera d’ailleurs sur un autre cliché, près du canal Saint-Martin. Car si Robert Doisneau "
s’est toujours trouvé un peu ridicule dans son attitude d’observation et d’attente, posté sans raison aux coins des rues sans pouvoir demander aux passants qu’ils l’acceptent", peut-on lire dans le catalogue de l’exposition, dès lors qu’il isolait un personnage, à l’anonymat de la foule ou du groupe succédait une relation presque d’amitié.
En banlieue comme à Paris, "les petites gens" - qui tiennent une place de choix dans l’exposition et plus généralement dans l’œuvre du photographe - deviennent des individualités. Il y a donc Pierrette, Josette qui fête ses vingt ans, Mademoiselle Anita, petite vertu mais grande solitude, Coco et sa trogne de travers, Richardot et ses tatouages de haut en bas, Monsieur Barré et son manège avachi tel un parapluie trop mouillé sans oublier Georges et Riton, des vraies gueules de demi-sel tout droit sorti d’un Melville de la première heure. Il faudrait encore citer tous ces clochards "
avec lesquels, reprend Agnès Sire,
Doisneau était très copain" et auxquels il réussit à rendre leur dignité, et même leur grandeur. Bref, tous les milieux pourvu qu’ils soient de la dèche ou de la débrouillardise : toujours à la périphérie, finalement, même intra muros. Bien sûr, Doisneau tirera le portrait de personnalités illustres comme Jacques Tati, Pablo Picasso ou Blaise Cendrars avec lequel il publiera un livre de photos intitulé
La Banlieue de Paris (1949), mais il s’agira presque toujours de commandes. Ce que rappelle la vitrine du deuxième étage de la Fondation réservée à ses "extras alimentaires" quand il s’adonne à la photographie publicitaire ou industrielle notamment pour le constructeur de véhicules Renault. C’est là d’ailleurs que les visiteurs pourront voir
Le Baiser de l’Hôtel de ville (1950) presque ravalé au rang d’accident de parcours et que l’auteur, pour l’anecdote, trouvait "
très gnangnan".
En fait de
Baiser de l’Hôtel de ville, parlons plutôt de
baisers, car à côté de l’icône est accrochée la photographie originelle avant recadrage. Une double présentation qui colle finalement à l’esprit de l’exposition, laquelle a tenu précisément à recadrer certaines images en partant du tirage original, leur redonnant ainsi une nouvelle vie et offrant aux spectateurs un nouvel angle de vue. Agnès Sire rappelle à cet égard que "
contrairement à Henri Cartier-Bresson qui très vite adopta un cadre précis, Doisneau lui ne s’est jamais vraiment attaché au devenir de ses photographies. On a ainsi beaucoup d’images qui sont tantôt verticales tantôt horizontales". Tout le sens du

titre de l’exposition,
Du métier à l’œuvre, tient dans cette observation car Doisneau s’est toujours considéré comme un artisan, quitte à regretter, non sans quelque amertume, d’avoir toute sa vie dû travailler pour subvenir aux besoins des siens et d’avoir peut-être manqué de temps et de rigueur - il se plaignait d’avoir trop photographié, et dans le désordre, passant dans une même journée d’un sujet à l’autre - pour construire un ensemble qui ait du sens, de la cohérence.
Or preuve est faite impasse Lebouis que l’œuvre de l’enfant de Gentilly n’est ni désordonnée, ni approximative. Toutes ces images prises avant 1966 constituent même un témoignage rare sur ce monde entre deux, en train de vaciller, ce que symbolise cette photographie prise en 1945 -
Entre Gentilly et Arcueil : au premier plan, une carrière, un énorme trou ; au second plan, comme posé sur le bord de cette menaçante béance, une couronne de minuscules habitations prêtes à être englouties. De ce point de vue, Doisneau est proche d’Eugène Atget - qu’il admirait - dans cette manière de consigner ce qui ne sera bientôt plus en le parant toutefois d’une forme d’intemporalité, et cela même si les démarches de l’un et l’autre étaient sans doute très différentes. "
Toute sa vie, il s’est construit son petit théâtre. Dans le but de prouver que son monde existe. […] Il cherchait à inscrire sa géographie secrète comme on grave dans un arbre", écrit Jean-François Chevrier dans le catalogue. Ce qui explique qu’il n’ait jamais hésité à faire "rejouer" une scène contrairement, là encore, à Cartier-Bresson, le photographe de l’instant. Le jeu pour oublier le quotidien maussade ? Le thème est récurrent chez Doisneau. Ainsi de cette photographie réalisée en 1945 et intitulée
Football, Choisy le Roi. A l’arbre rachitique et isolé du premier plan répondent dans le lointain les silhouettes hérissées et fumantes d’usines et d’industries qui bouchent l’horizon, tandis que sur un terrain vague un groupe d’enfants se passe le ballon.
Autre paradoxe : c’est sur ce monde en voie de disparition auquel il était si attaché que Doisneau a réussi à exprimer une modernité qui "
renvoie carrément à des photographes comme Stéphane Couturier à l’instar de cette image appelée Rue des Nonnains d’Hyères
(1961) qui montre un pignon sur lequel se laissent voir les traces des étages et des cheminées de l’immeuble attenant, après sa démolition". Agnès Sire se dit pareillement impressionnée par son sens de l’équilibre et de l’espace. Et de montrer cette autre photographie,
Place de la gare,
Ivry, 1946, qui "
pourrait être une scène de film. On dirait du Trauner. Et c’est vrai qu’il aimait que l’espace soit bien distribué autour des gens". Nombre de ses photographies sont d’ailleurs prises d’un point élevé, toit, balcon ou talus. On songe tout particulièrement à
Cirque à Gentilly (1948) ce cliché pris de nuit de la fenêtre d’un immeuble de six ou sept étages : à gauche, le trapéziste au dessus d’une piste à ciel ouvert entourée de dizaines de spectateurs et à droite, telle une signature, le mot "
Photographe" écrit au-dessus de la vitrine d’une boutique en rez-de-chaussée. On croirait un autoportrait en "
saltimbanque de la banlieue" pour reprendre l’expression de Jean-François Chevrier.
Pas étonnant que Cartier-Bresson ait choisi d’installer Doisneau sur un toit parisien pour réaliser son portrait en 1986. Avec, dans le fond, le Sacré-Cœur, symbole - que l’on prendra cependant au pied de la lettre pour ne pas froisser la mémoire de l’ancien résistant et communiste - qui convient si bien à cet homme qui même dans la gravité n’a jamais renoncé à la tendresse. C’est du reste avec ses photographies de "fêtes" que s’achève le périple avec cet artiste malgré lui, faux sentimental mais vrai mélancolique.
 suivante de sa semelle d’arpenteur partagé entre onirisme et réalisme. Les deux photographies qui, en guise de préambule, succèdent aux Pavés donnent en effet le ton : côte à côte, La chambre de Gentilly (1930) où il vit et qui, avec ses rideaux brodés, son papier-peint fleuri et ses meubles "de famille", respire le confinement, l’ennui, la réclusion, et Le nez au carreau (1953), image prise rue Pajol à Paris et sur laquelle on peut voir une fillette debout sur une table scrutant la rue, l’extérieur, l’inconnu, à travers la vitrine d’un café. Un raccourci qui dit bien la nécessité vitale pour Robert Doisneau qui "exécrait le milieu petit-bourgeois" de s’échapper, de passer de l’autre côté de la fenêtre.
suivante de sa semelle d’arpenteur partagé entre onirisme et réalisme. Les deux photographies qui, en guise de préambule, succèdent aux Pavés donnent en effet le ton : côte à côte, La chambre de Gentilly (1930) où il vit et qui, avec ses rideaux brodés, son papier-peint fleuri et ses meubles "de famille", respire le confinement, l’ennui, la réclusion, et Le nez au carreau (1953), image prise rue Pajol à Paris et sur laquelle on peut voir une fillette debout sur une table scrutant la rue, l’extérieur, l’inconnu, à travers la vitrine d’un café. Un raccourci qui dit bien la nécessité vitale pour Robert Doisneau qui "exécrait le milieu petit-bourgeois" de s’échapper, de passer de l’autre côté de la fenêtre. titre de l’exposition, Du métier à l’œuvre, tient dans cette observation car Doisneau s’est toujours considéré comme un artisan, quitte à regretter, non sans quelque amertume, d’avoir toute sa vie dû travailler pour subvenir aux besoins des siens et d’avoir peut-être manqué de temps et de rigueur - il se plaignait d’avoir trop photographié, et dans le désordre, passant dans une même journée d’un sujet à l’autre - pour construire un ensemble qui ait du sens, de la cohérence.
titre de l’exposition, Du métier à l’œuvre, tient dans cette observation car Doisneau s’est toujours considéré comme un artisan, quitte à regretter, non sans quelque amertume, d’avoir toute sa vie dû travailler pour subvenir aux besoins des siens et d’avoir peut-être manqué de temps et de rigueur - il se plaignait d’avoir trop photographié, et dans le désordre, passant dans une même journée d’un sujet à l’autre - pour construire un ensemble qui ait du sens, de la cohérence.